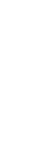Management Anglo-Français plus que le “bon mot”.

Novembre 2010 – Dans un entretien accordé à Robert Dick, directeur de Global Talent Network (GTN), Antoine Tirard explique à quels besoins répond le dictionnaire français-anglais des ressources humaines dont il est co-auteur, quelles étaient les difficultés pour l’écrire et le mettre à jour, et ce qu’il apporte au-delà de la simple traduction.
Qu’est-ce qui vous a convaincus qu’un dictionnaire français-anglais des RH était nécessaire ?
Ce dictionnaire est né dans les années 1990 au départ comme réponse à un besoin personnel. Mon co-auteur et moi-même travaillions tous les deux comme DRH dans des entreprises internationales à Paris. Nous étions régulièrement confrontés à des difficultés de communication franco-anglaise, et trouvions peu de termes RH dans les dictionnaires usuels. Nous avons a commencé alors à noter des listes de termes pour notre usage personnel. Au fur et à mesure que ces listes s’agrandissaient, nous avons réalisé que notre travail pouvait aider d’autres professionnels des RH. C’est ainsi que nous sommes arrivés à l’idée d’écrire un dictionnaire spécialisé dans les RH. Nous voulions qu’il inclue tout le vocabulaire qu’un DRH peut rencontrer au cours de son travail quotidien – des concepts managériaux les plus larges, jusqu’au jargon RH le plus pointu.
Concrètement, quels sont les défis rencontrés dans l’écriture d’un dictionnaire comme celui-ci ?
Cela nous a pris quatre ans pour écrire la première édition du dictionnaire. La première difficulté était de collecter toutes les entrées pertinentes. Notre vie quotidienne est devenue un véritable terrain de chasse. Nous recueillions des termes ou des expressions à partir de sources multiples– revues spécialisées, livrets d’accueil du personnel, manuels de formation, rapports d’experts — ainsi qu’à travers les interactions avec nos collègues parlant l’anglais.
Le second défi est que souvent il n’y a pas de correspondance littérale entre certains termes français et anglais. Par exemple, en France, le terme ‘Grandes Ecoles’ est unique au système éducatif français, aussi une traduction directe est à la fois impossible et inutile. Il vaut mieux expliquer cette expression plutôt que la traduire. Dans cet exemple, une ‘Grande Ecole’ est en anglais “a prestigious French business or engineering school with highly selective entrance exams”.
Le dictionnaire est-il mis à jour ?
Voilà le troisième défi avec ce genre d’ouvrage: c’est une histoire qui ne s’arrête jamais! La gestion des RH évolue en permanence. Chaque année amène son lot de nouvelle législation ou de nouvelles pratiques managériales. C’est pourquoi le dictionnaire en est à sa 4ème édition. On ne cesse de le mettre à jour. Dans la dernière édition, par exemple, nous avons couvert de nouveaux termes autour du développement durable, de la diversité et de l’inclusion, de l’engagement des salariés, et de la marque employeur.
Quel retour recevez-vous de vos utilisateurs?
Nos ‘lecteurs’ nous disent que le dictionnaire est un support précieux pour leurs activités quotidiennes. Ils l’utilisent pour des traductions, pour trouver différentes façons d’exprimer quelque chose, ou simplement pour vérifier le sens d’une expression nouvelle. Clairement, ce n’est pas comme un livre de management qu’on lit pour ensuite le ranger sur une étagère. C’est un véritable outil, et comme pour tout bon outil, les gens aiment le garder à portée de la main. Un juriste senior en droit du travail m’a confié que son exemplaire du dictionnaire reposait sur son bureau en permanence, et que d’ailleurs elle devait en acheter un autre car les pages étaient toutes cornées et détachées
Où le dictionnaire s’est-il le mieux vendu?
Le dictionnaire s’est vendu à plus de 15.000 exemplaires depuis son lancement en 1995. Au début, les ventes venaient principalement du marché français. Nous avons observé depuis une augmentation des ventes en Grande-Bretagne, au Canada, et aux Etats-Unis, largement due à l’émergence des sites E-commerce tels qu’Amazon.com.
On rencontre certainement d’autres barrières en travaillant dans un environnement franco-anglais. Il ne s’agit pas simplement de trouver “le bon mot”?
C’est très juste. Souvent, même aller au-delà de la traduction mot-à-mot en expliquant un terme RH ne suffit pas à communiquer son essence. Si vous prenez un sujet comme la retraite par exemple, vous pouvez bien sûr définir certains des termes les plus utilisés dans chaque pays, mais cela n’offre pas au lecteur une compréhension globale du fonctionnement d’un système de retraite. C’est pourquoi dans la seconde édition, nous avons ajouté une nouvelle partie faisant figurer des tableaux, des schémas et des diagrammes pour expliquer certains des thèmes les plus importants des RH tels que l’éducation, la formation, le droit du travail, le contentieux, les systèmes de retraite, ou les stock-options.
Le monde anglophone s’étend bien au-delà du monde francophone. En dehors de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis, comment est-ce que le dictionnaire peut aider, disons en Australie, en Afrique du Sud, ou aux Caraïbes, où l’usage de l’anglais revêt des caractéristiques particulières?
Jusqu’à présent, le dictionnaire couvre le vocabulaire utilisé en France, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, car ces trois pays représentent une part importante de lecteurs dans le monde des affaires. Je crois qu’un professionnel des RH australien qui utilise le dictionnaire trouvera l’essentiel de ce qu’il recherche, même si certains termes RH spécifiques à l’Australie ne sont pas abordés. Mais c’est une bonne suggestion que nous devrions considérer pour notre prochaine édition! En ce qui concerne la partie française, l’accent est mis sur la France. Nous pourrions envisager pour les prochaines éditions le vocabulaire RH utilisée au Canada, en Belgique, ou en Suisse francophones.
Pouvez-vous citer des exemples spécifiques où même la meilleure utilisation de la langue n’est pas suffisante?
Ce qui est fascinant avec une langue, c’est qu’elle en dit beaucoup sur la culture d’un pays. Nous étions frappés de réaliser que par exemple le mots anglais ‘feedback’, ‘empowerment’ ou ‘accountability’ n’ont pas de bons équivalents en français. Le mieux que nous avons trouvé était ‘retour d’information’ pour feedback, ‘délégation de responsabilités’ pour empowerment et ‘devoir de rendre compte’ pour accountability. Mais à l’évidence, aucune de ces traductions quelque peu longues et maladroites ne reflètent l’esprit réel de ces pratiques managériales.
Les entreprises françaises sont connues pour être plus hiérarchiques que les anglo-américaines. Par exemple, les prénoms ne sont pas si souvent utilisés. Comment est-ce que votre dictionnaire aide dans ce genre de circonstances ?
Les trois exemples que je viens de citer illustrent bien votre propos selon lequel les entreprises française sont plus hiérarchiques. En effet, la culture managériale française tend à être plus centralisée et autoritaire. La crédibilité des managers est étroitement associée à leurs capacités intellectuelles et à leurs compétences techniques. Avec ces caractéristiques culturelles, il n’est pas surprenant de constater que des mots comme ‘coaching’ ou ‘empowerment’ – qui sont des approches de management plus consultatives – ne font pas vraiment partie du lexique managérial français.
Beaucoup d’innovations du monde des affaires sont originaires des Etats-Unis. Comment cela a-t-il influencé votre dictionnaire?
Cela a influencé la pagination! La partie anglaise du dictionnaire est environ 10% plus longue que la partie française. Ce qui est vrai pour les innovations dans les affaires en général est aussi vrai pour les innovations dans la gestion des RH. J’ai vécu cela personnellement lorsque j’ai travaillé aux Etats-Unis. J’ai trouvé que les communautés de professionnels des RH essayaient en permanence de créer et d’améliorer leurs outils et leurs pratiques. La recherche de professionnalisation de la fonction est prise plus au sérieux. Ceci est soutenu par les universités – telles que Michigan ou Cornell – qui consacrent des ressources considérables à la recherche et qui encouragent les partenariats avec les professionnels des RH.
Est-il vrai que le système de RH français est plus procédurier alors que l’approche anglo-américaine est plus “libre marché” ?
C’est probablement vrai si vous observez les systèmes RH du point de vue de la législation du travail.Au cours des deux dernières décennies, le gouvernement français a changé de bord de nombreuses fois, et les partis de Droite comme ceux de Gauche ont créé leur propre législation, en la superposant à la précédente. L’exemple le plus marquant est la semaine de 35 heures. Elle a été adoptée en 2000 sous un gouvernement de cohabitation dirigé par la Gauche, puis remise en question par la Droite qui a créé des nouvelles mesures pour la contourner ou amoindrir son impact, sans pour autant la supprimer. Du coup, les responsables RH qui travaillent en France doivent en permanence adapter leurs politiques et leurs pratiques, et souvent négocier de nouveaux accords collectifs.
Cependant, dans de nombreux autres domaines des RH, c’est pratiquement la situation inverse. Si vous prenez par exemple la gestion de la succession, bon nombre d’entreprises françaises n’approchent pas ce sujet avec rigueur et discipline. A l’inverse, aux Etats-Unis, la Securities and Exchange Commission vient juste de publier un nouveau règlement qui impose l’examen minutieux des pratiques de succession planning des entreprises cotées, augmentant ainsi le poids de la responsabilité des membres du conseil d’administration.
Vous pouvez acheter un exemplaire du livre d’Antoine, Dictionnaire des Ressources Humaines, sur Amazon.co.uk et Amazon.fr